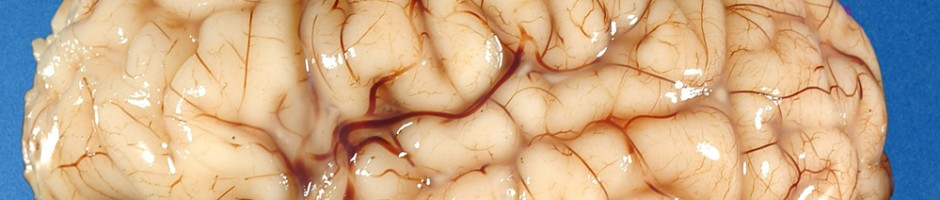Face à l’afflux d’étudiants et au sous-financement chronique de l’enseignement supérieur en Belgique francophone, une réflexion s’engage, en coulisse, sur l’instauration de prérequis à l’entrée des études. Pour ses partisans, les tests d’entrée obligatoires permettraient de réduire le taux d’échec. Pour ses adversaires, c’est l’école secondaire qu’il faut réformer en priorité. Enquête.
Le rapport dort-il dans un tiroir ? Présenté il y a six mois par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares), celle qui chapeaute les hautes écoles et les universités francophones belges, il avait alors jeté le trouble. Plus d’une année de travail et une quinzaine d’experts indépendants francophones, flamands, français, allemands et suisses, professionnels du système éducatif, dirigeants d’entreprise, hauts cadres de l’administration, représentants de la recherche : le document de 84 pages, intitulé L’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’horizon 2030 , condense leurs conclusions. Et là où, d’ordinaire, seuls de prudents propos sont échangés tant les thèmes fâchent et divisent, ses signataires formulent des perspectives fortes en dix-huit propositions. « Elles sont urgentes, sans quoi l’enseignement supérieur risque d’être dépassé », estime le professeur Jean-Pierre Finance, ancien président de l’université Henri Poincaré (France), qui a conduit les travaux. Sur des points aussi sensibles que le financement des universités, l’autonomie des établissements, leur réduction par des fusions ou des regroupements, ou encore la généralisation de tests obligatoires à l’entrée des études, ils ne se sont interdit aucun sujet. « Ce rapport dérange. Il est fait pour cela. La mission adressée aux experts par le président d’alors, feu Philippe Maystadt, était de sortir des ornières idéologiques par des propositions pragmatiques et réalistes », commente, au Vif/L’Express, Julien Nicaise, administrateur de l’Ares.
Les syndicats étudiants avaient d’emblée réagi en exprimant leurs griefs sur certaines des propositions. Il en est ainsi du libre accès aux études supérieures. Les députés du parlement francophone, eux aussi, avaient interpellé Jean-Claude Marcourt (PS), ministre de l’Enseignement supérieur, qui leur avait opposé l’argument : « Il s’agit d’une initiative tout à fait autonome de l’Ares », prenant soin de poser les limites de l’exercice et de prendre ses distances. En d’autres termes : que l’Ares cogite et un profond tiroir accueillera son rapport ? « Nous souhaitons évidemment une réponse politique de la part du gouvernement, répond Julien Nicaise. A quelques mois d’échéances électorales, le débat pourrait s’engager. » Ou pas.
En revanche, et en réaction à la note, les recteurs ont débattu et préparent une réponse commune. Elle aboutira ce mois-ci. Quant à l’Ares, après avoir cogité en privé, elle engagera, en septembre prochain, sa « phase publique », puisqu’elle fera connaître sa position officielle sur les pistes avancées par les experts.
L’une d’elles s’avère explosive. La onzième mesure du document émet ainsi la nécessité d’instaurer « des tests d’orientation obligatoires à l’entrée ». Elle précise que « la non-réussite du test pourrait donner lieu à des contraintes selon les cas, en particulier de devoir suivre des activités de remédiation ».
Certaines expressions doivent être maniées avec d’infinies précautions. Le collège l’a compris en utilisant une forme verbale relativement soft. « Mais je ne vous cache pas que certains auraient aimé aller plus loin et prôner un processus contraignant », remarque Jean-Paul Lambert, économiste, recteur honoraire à l’université Saint-Louis, par ailleurs membre du panel d’experts. Le texte n’en est pas moins polémique. Il rouvre le dossier miné du libre accès à l’enseignement supérieur et de ce que l’on peut qualifier de « mode de recrutement » des étudiants, « d’orientation prédictive » ou encore « d’orientation renforcée ». En on , ces propos se révèlent quasiment imprononçables. « Le terme « tabou » est trop fort, mais la question de la sélection reste peu débattue, observe Julien Nicaise. Elle demeure un réel sujet de discorde. Les avis sont très opposés, et ceux qui soutiennent un possible tri à l’entrée ne s’expriment guère et sont peu audibles. Or, il en existe, entre autres sur le terrain
politique, à gauche comme à droite. » On en rencontre évidemment ailleurs, au premier rang desquels des enseignants des universités et des hautes écoles, qui en parlent… entre eux. « Il y a cinq ans, vous n’auriez pas lu cela dans un rapport. L’idée gagne chaque année de nouveaux partisans. S’opposer à un « filtrage » à l’entrée, sous l’une ou l’autre modalité, devient plus rude », note Jean-Paul Lambert.
Selon lui, la tentation de fermer un peu plus la porte serait « la solution du désespoir dû au sous-financement chronique », qui rend la situation très tendue. En effet, la Belgique doit résoudre la même équation que ses voisins : comment faire face à un enseignement supérieur de masse sans sacrifier la qualité ? Mais à laquelle il faut ajouter, pour notre part, un définancement structurel jamais vu ailleurs. Des chiffres illustrent cet énoncé insoluble : en vingt ans, les effectifs étudiants ont progressé de 36 % ; les moyens alloués par étudiant aux institutions ont été rabotés de 15 % ; le ratio étudiants-enseignants s’est sévèrement dégradé, inférieur aujourd’hui de 15 à 20 % par rapport à l’évolution des étudiants. Ce qui situe la Belgique francophone à 13 % en dessous de la moyenne des pays considérés comme développés et à 23 % en dessous de ses proches voisins. Le mode de financement, mis en place depuis
2016, doit permettre d’injecter 41 millions d’euros annuels d’ici à la fin de la législature. Un montant largement insuffisant pour rattraper le sous-financement, selon le collège d’experts, pour qui ce sont 50 millions annuels qu’il faut trouver. « D’ici 2030, ce niveau d’enseignement pourrait accueillir jusqu’à 70 000 étudiants supplémentaires », détaille Julien Nicaise.
L’actuelle sélection est hypocrite et cruelle
Dans ses tableaux, l’administration communautaire dresse aussi le portrait chiffré de la population étudiante. Ces statistiques tendent à accréditer l’idée d’une sélection la plus hypocrite, la plus cruelle qui soit : le tri par l’échec. En Belgique, chaque titulaire d’un CESS, le certificat d’enseignement secondaire supérieur, peut s’inscrire dans la filière de son choix, à l’exception de quelques disciplines (la médecine, les soins dentaires, l’ingénierie et les arts). Près de huit rhétoriciens sur dix entament ainsi un cursus supérieur. Leur taux de réussite moyen en 1re bac s’élève à 35 % (39 % en haute école, 36 % à l’université, et ce avant le décret « Paysage » qui a changé les règles en 2014). Un taux qui ne progresse pas, qui diminuerait même ces dix dernières années, selon les indices collectés par l’économiste Jean-Paul Lambert.
Dans ces montagnes de données, on trouve aussi des statistiques qui font peur : en haute école, le taux de réussite en 1re bac des titulaires d’un CESS professionnel n’est que de 14 %, contre 52 % pour les élèves issus du général. Les titulaires d’un diplôme de technique de qualification font à peine mieux : 27 % de réussite. Ceux qui sortent de technique de transition affichent, eux, 41 % de réussite. Une scolarité sans redoublement accroît les chances de succès. Pour ceux qui sortent du secondaire en temps et en heure, le taux de réussite s’élève à 53,7 % en haute école, et à 43,9 % à l’université. En revanche, les doubleurs affichent un taux de 32,2 % en haute école et de 22,1 % à l’université. Les disparités sont donc grandes derrière la statistique globale selon laquelle 35 % seulement des nouveaux étudiants passent le cap de la première année. Voilà pour les chiffres.
L’élimination est sévère. Elle frappe de façon inégale. « L’origine du problème se trouve dans la culture du redoublement et, de son corollaire, la relégation en cascade dans les filières techniques et professionnelle, affirme Jean-Paul Lambert. Résultat : les élèves issus du secondaire général à l’entrée du supérieur se réduit chaque année, au profit des élèves venus des voies techniques – leur taux a augmenté de plus de 20 % depuis 2009 – ou professionnelle, nettement moins, voire pas du tout préparés aux exigences de l’enseignement supérieur. »
Après l’école, l’université et la haute école se trouvent démunies face à ces nouveaux profils d’élèves. Pour ces jeunes qui ont besoin d’un encadrement très serré, elles ont mis en place des dispositifs d’aide à la réussite : des cours préparatoires durant l’été, un tutorat renforcé, des séances de travail en petits groupes, des tests non contraignants destinés à évaluer les prérequis nécessaires dans chaque filière… Difficile d’évaluer tous ces dispositifs de soutien. Sont-ils efficaces ? En décembre 2015, les Facultés Saint-Louis ont évalué le « Passeport pour le bac » qu’elles soumettent à leurs étudiants. Un constat : les résultats sont comparables à ceux obtenus à Namur et à l’UCL. L’aide à la réussite ne ferait pas de miracle. Elle « dope » les notes – elle fait gagner deux points en moyenne – mais elle se révèle rarement suffisante pour permettre la réussite. Même chose pour le blocus assisté qui joue à la marge : « Ce sont généralement ceux qui ne sont pas en total décrochage, mais proches de la réussite qui sont aidés par la guidance, dit Marc Lits, prorecteur à l’enseignement et à la formation à l’UCL. Par contre, l’étudiant qui est totalement perdu ne fera pas la démarche pour se faire aider. » D’ailleurs, seuls 10 à 15 % des étudiants participent aux activités de remédiation. Alors que, s’indignent d’aucuns en coulisse, cela nécessite des moyens importants dans un contexte budgétaire anémique.
Système bancal
Ces constats nourrissent les arguments de ceux qui souhaitent introduire un possible tri à l’entrée. « Plus personne ne peut défendre le fonctionnement actuel, avance un professeur d’université, autrefois recteur. Ne pas orienter fermement aboutit à dégrader la formation de tous les étudiants et à faire perdre du temps aux plus faibles. » Ce que les auteurs du rapport expliquaient également entre les lignes : « Dans le contexte d’un enseignement obligatoire n’organisant pas d’examen terminal généralisé à l’échelle de son territoire comme, par exemple, le baccalauréat français, l’obligation d’un test permettrait de réduire l’échec, d’améliorer l’orientation professionnelle et de favoriser un meilleur encadrement. » Pour appuyer leur argumentaire, ils rappellent que les tests de prérequis sont massivement prédictifs de la réussite. Ainsi, une recherche interuniversitaire menée en 2017 montrait que ceux réalisés en début d’année, à l’exemple du « Passeport pour le bac », un test non obligatoire et non contraignant, sont « d’assez bons évaluateurs de la performance aux examens de janvier ». « Ce sont de bons signaux d’avertissement. Ils permettent aux étudiants de réagir et de mettre tout en œuvre pour pallier les lacunes identifiées dans le test. » Et des chercheurs d’aller plus loin en recommandant que ces tests soient effectués avant même que l’élève ait posé définitivement son choix d’études. « Cela pourrait permettre aux étudiants de mieux s’orienter. »
« L’idée d’une sélection n’est pas scandaleuse dans certaines sociétés, à l’instar des pays anglo-saxons et d’Europe du Nord, parce que leur école secondaire n’est pas stratifiée et se montre peu inégalitaire socialement », avance Jean-Paul Lambert. En revanche, l’école francophone creuse les différences sociales, comme le montrent régulièrement les enquêtes internationales : elle demeure la plus inégalitaire de toute l’OCDE. « Chez nous, l’argument d’une sélection n’est pas acceptable parce que dans notre contexte, il se révèle moralement injuste », poursuit l’économiste, ajoutant qu’il s’agirait de sanctionner a posteriori un parcours dans le secondaire, alors qu’on sait qu’il trie les élèves, année après année, que les écarts entre établissements scolaires sont colossaux et que les milieux les plus défavorisés sont surreprésentés dans les écoles faibles.
D’autres facteurs expliquent cette réticence à la sélection, même « douce », soit un test d’orientation généralisé non contraignant. « L’expérience du test de médecine, avant qu’il ne soit éliminatoire, a montré que ça ne fonctionne pas, juge Calogero Conti, recteur de l’université de Mons, résumant ainsi une position fort répandue parmi ses collègues. Lorsqu’un test non contraignant indique à l’étudiant qu’il n’a pas le niveau pour entamer telle filière, celui-ci ignore le résultat et persévère jusqu’à l’échec. »
Un autre élément, souvent occulté, vient soutenir les hostilités à une barrière à l’entrée des études. On peut parler d’angle mort de l’examen d’entrée. Sur le terrain de la psychologie de l’orientation, tous les théoriciens des mécanismes constatent ainsi qu’il existe dans tout test sélectif des « faux positifs » : des étudiants qui réussissent tout juste le test mais qui finiront, après l’un ou l’autre échec et/ou réorientation par abandonner sans avoir décroché un diplôme. « Pour ceux-là, il n’y a aucune injustice parce qu’ils se sont vus donner leur chance », avance Jean-Paul Lambert. Evoquant l’examen d’entrée menant aux études d’ingénieur civil, le professeur signale qu’il n’est pas à l’abri de ce type d’erreur, puisque près de 30 % des admis n’obtiennent finalement pas le diplôme convoité.
En revanche, il y a les « faux négatifs » : ceux-là, malgré un échec au test, auraient peut-être poursuivi jusqu’à l’obtention du diplôme. On ignore leur nombre mais il faudrait partir, selon les spécialistes, de l’hypothèse qu’ils seraient aussi nombreux que les « faux positifs ». « L’enjeu, c’est évidemment ceux-là, parce que ce type d’erreur est grave et que, chez nous, elle concernera plus que proportionnellement les élèves issus de milieux modestes, provenant d’écoles faibles. »
« Que fait-on des recalés ? », interroge Calogero Conti. Une partie sans doute se tournerait vers la haute école, « reléguée » aux formations courtes. En guise d’alternative, le collège d’experts propose une année de remise à niveau sous forme d’année de propédeutique par domaine (santé, sciences, économie… ) et qui jouerait aussi le rôle d’année d’assimilation de la culture académique, d’année d’orientation ou de révélateur de potentiel. Parallèlement, le collège avance l’idée de développer des formations moins spécialisées à l’entrée de l’université. En première année, l’étudiant pourrait choisir un secteur (sciences et techniques, sciences humaines, sciences sociales, droit et économie, etc.). Le programme de cours s’affinerait à l’issue de deux ou trois quadrimestres. Cette solution, elle aussi, ne rencontre guère l’enthousiasme, les académiques estimant qu’ils n’ont pas à se substituer à l’école secondaire et à y apporter des corrections.
Vers une sélection « douce » ?
Cependant, à force d’être macérée, infusée, digérée, la question de la sélection a évolué. On voit déjà bouger les lignes. D’aucuns avancent, encore mezza voce , un « filtre intermédiaire ». Il s’agirait d’instaurer différentes catégories d’élèves, qui, en fonction de leur orientation
dans le secondaire et des notes qu’ils y ont obtenues, soit pourraient obtenir une place de droit à l’université ou en haute école, soit devraient passer un test contraignant. En cas d’échec, une année propédeutique, dont le programme serait clairement défini, leur serait proposée pour combler leurs lacunes. « L’objectif premier est d’en finir avec l’idée que tous les diplômes de secondaire se valent », avance l’un des partisans d’une « sélection douce ».
L’idée d’un filtre intermédiaire rencontre peu d’adeptes, en réalité, et beaucoup de dirigeants d’université rejettent une véritable sélection, voire un test diagnostic comme avancer dans le rapport d’experts. Mais le souci de mieux répartir les élèves en fonction de leurs chances de réussite a également gagné du terrain. Orientation renforcée d’un côté, orientation directive de l’autre. Le point de consensus n’est peut-être pas si loin. Les recteurs voient dans l’« orientation concertée » une façon de résoudre en partie l’intenable équation. « Il s’agit plus d’orienter que de sélectionner », assure Marc Lits, prorecteur à l’UCL. « Ce n’est pas tant l’absence de sélection qui est source d’échec que l’absence d’orientation. » Ils veulent « une vraie orientation active », avant la rhéto plutôt qu’au début du supérieur, avec « un accompagnement personnalisé tout au long du continuum 4e secondaire – 1re bac : les jeunes seraient inscrits dans une filière à partir d’une analyse fine de leur dossier, ce qui suppose un travail commun entre les enseignants du second degré et du supérieur, notamment sur les prérequis à maîtriser.
C’est la voie qu’a choisie la Flandre et qui pourrait nous servir d’exemple, selon Jean-Paul Lambert. Elle n’a pas souffert d’un désinvestissement massif et continu de son enseignement supérieur. C’est un autre revers qui l’a amenée à mettre en place, dès la rentrée de 2019, dans au moins deux universités (Gand et Louvain), un test d’orientation obligatoire : le très net allongement des études à la suite du flexibilisering . Ce dispositif permet à l’étudiant, depuis 2005, en Flandre – 2013 en FWB – de valider une partie de son bac par la capitalisation des crédits ECTS (système européen de transfert et d’accumulation de crédits). Le système lui permet ainsi de poursuivre dans l’année supérieure avec 45 crédits sur les 60 nécessaires à la sanction d’une année. Autrement dit, il peut passer dans l’année supérieure en emmenant dans sa valise trois, voire quatre cours échoués, et qui s’ajouteront aux 60 requis de l’année suivante.
« Il est sans doute trop tôt pour évaluer ce système chez nous, mais tous les indicateurs signalent que,